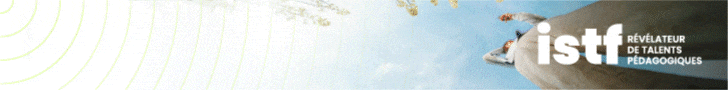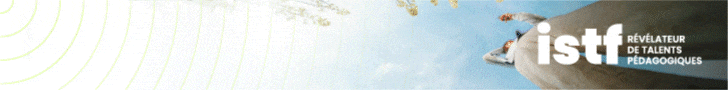|
Troisième étape du parcours « La veille en formation » : Isabelle Dremeau et Michel Diaz s’intéressent aux dynamiques collaboratives. Comment articuler les rôles, partager les informations et instaurer une véritable culture de veille au sein des équipes ?
 La veille en formation : activité individuelle ou collective ?
Michel Diaz : Les deux ! D’abord la responsabilité est individuelle. Car si, d’une façon générale, la veille est partie intégrante d’un grand nombre de métiers, c’est encore plus vrai pour les métiers du savoir, et notamment pour les métiers de la formation ; les concepteurs pédagogiques ou les formateurs doivent en permanence se préoccuper de la meilleure façon d’aider les apprenants à conforter ou à construire des compétences. De ce point de vue, ils s'intéresseront aux fondamentaux de la pédagogie qui, malgré la remarquable stabilité de ses modèles (on peut penser à celui de Knowles comme à bien d'autres), continuent d’évoluer avec les avancées des sciences cognitives. Mais on a également vu ces métiers percutés de plein fouet par les innovations technologiques, parmi lesquelles, depuis trois ans, l’intelligence générative qui ouvre des portes… et en ferme d’autres ! Responsabilité individuelle, donc, du formateur, du concepteur pédagogique, de l’administrateur de plateforme de formation, et même des gestionnaires, compte tenu du risque qu’ils courent à demeurer dans des tâches routinières…
La veille est aussi une activité collective ?
Michel Diaz : En effet, parce quer, aussi motivé soit-il, un individu ne peut embrasser “fonctionnellement” tous les domaines de formation - contenus, plateformes, outils, pratiques, stratégies, fondamentaux… - travaillés par les innovations. Ensuite, parce que la veille est fort consommatrice de temps : si rares sont les personnes qui peuvent y consacrer 50 % de leur emploi du temps, cinq membres (par exemple) d'une équipe formation pourront y dédier plus raisonnablement 10 % de leur temps. Cela suppose évidemment une organisation particulière, bien réfléchie en amont, une véritable stratégie, comme on l’a mentionné dans un volet précédent de cette série. Enfin, surtout, la pratique collective de la veille, le partage des informations, la confrontation des points de vue permettront d’approfondir l’analyse, et notamment d’identifier la valeur des produits et des services engagés dans cette activité de veille. On notera ici que cet exercice d’intelligence collective dépasse largement l'implication du seul service formation : il englobe la veille que les businesses de l’entreprise peuvent mener de leur côté, et, hors les murs de l’entreprise, il monopolise la veille des pairs à travers, par exemple, des “learning expeditions”. Bref, tout ce qui peut être mutualisé doit l’être, sans oublier que l’entreprise ne retiendra de l’activité de veille que ce qu’elle peut s’approprier selon son contexte (culture, secteur d’activité, organisation, démographie, etc.) et ses besoins.
La collaboration qui vient d’être prônée suppose des outils spécifiques ?
Isabelle Dremeau : Oui : pour que l’intelligence collective prenne toute sa mesure, il est essentiel de s’appuyer sur des outils qui facilitent la collaboration et la rendent productive. Des outils qui permettent aux équipes de partager rapidement leurs trouvailles et de construire une veille vivante. Concrètement, les premières briques reposent sur les outils de collecte du quotidien : les agrégateurs de flux RSS dont nous avons parlé dans le premier article, les alertes automatisées (Google Alerts), les extensions de navigateur (Pocket, Felo.ai) ou encore le suivi de fils spécialisés sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. À ce stade, l’IA apporte une valeur ajoutée intéressante grâce à la rapidité de traitement de données massives et la génération de résumés structurés. Mais n’oublions pas que seul le chargé de veille garantit la pertinence en évaluant, triant et contextualisant les informations selon les enjeux de l’organisation.
Une fois l’information repérée, il faut la rendre visible et exploitable…
Isabelle Dremeau : Les plateformes collaboratives comme Notion, Wakelet, Scoop.it ou Slack sont idéales pour mutualiser les apports en créant des banques de connaissances. Elles permettent à chacun d’ajouter, de commenter, de taguer et de valoriser ses trouvailles. L’IA à nouveau servira à regrouper les informations des uns et des autres, peut-être à identifier des tendances et à livrer une première analyse clé en main. Par ailleurs, un point souvent oublié mais déterminant dans la mise en place d’une veille collaborative, c’est l’animation de la communauté des collaborateurs en veille. Elle est fondamentale, car sans elle le système de veille, aussi puissant soit-il, perdra de son efficacité. L’animation peut revêtir des formes variées : des rendez-vous courts mais réguliers (15 minutes chaque semaine, un « Café-Veille » par mois, le « point veille du vendredi ») ou encore des formats ciblés autour d’une information à explorer sous différents angles (vidéo, podcast, newsletter, sondage). Les rituels collectifs feront toute la différence. Ils peuvent être ludiques, proposés sous forme de défis ou plus formels avec des analyses réflexives sur les tendances. L’IA joue à tout niveau un rôle pivot : elle démocratise le travail de veille en abaissant les frontières de la collecte, de l’analyse et de la rédaction. L’équipe de veille … veille et assure la coordination, la qualité et la portée stratégique des contributions au travers de cette émulation collective. Enfin, même avec l’IA, un point reste essentiel : les responsables de veille doivent s’assurer que tout ce qui circule (en entrée comme en sortie) est fiable, pertinent et exploitable. C’est cette exigence de qualité qui valorise le travail collectif et inscrit la veille dans les valeurs et la culture de l’entreprise.
Volet 1 : De l’armoire à catalogues à la veille partagée : la transformation d’une pratique clé de la formation
Volet 2 : Stratégies et outils : comment structurer une veille informationnelle efficace ?
|